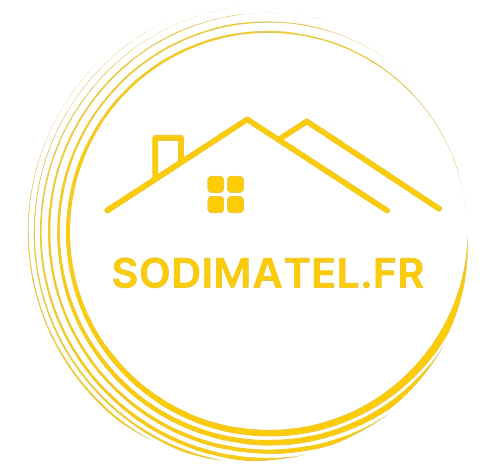Le système ribo, ou réseau d’assainissement par infiltration biologique optimisée, fonctionne très bien dans certains contextes, mais n’est pas adapté à toutes les situations. Il s’agit d’un dispositif de traitement des eaux usées qui repose sur la phytoépuration, utilisant les plantes, les micro-organismes du sol et une série de filtres naturels pour purifier l’eau avant de la réintégrer au milieu naturel. Si ce système séduit de plus en plus d’autoconstructeurs et d’écologistes, il présente aussi des limites techniques, réglementaires et financières qu’il convient d’évaluer avec précision. Voici notre retour complet sur les avantages et les inconvénients du système ribo.
Un système écologique qui respecte les cycles naturels
L’un des premiers atouts du système ribo, c’est sa capacité à épurer les eaux usées sans recours aux produits chimiques ni énergie mécanique. L’eau passe à travers une succession de bassins filtrants, où cohabitent des substrats minéraux (graviers, sable) et des végétaux adaptés comme le roseau, la menthe aquatique ou l’iris. Cette biodiversité permet de dégrader efficacement la matière organique, les nutriments et certains polluants.
Ce fonctionnement passif réduit fortement l’empreinte carbone de l’installation. Sur une étude menée en région Centre-Val de Loire en 2021, les foyers équipés d’un système ribo consommaient en moyenne 10 fois moins d’énergie que ceux raccordés à une microstation électrique. Ce système évite aussi les rejets brutaux d’eau traitée, ce qui limite l’érosion et respecte mieux la faune aquatique locale.
La valorisation de l’eau traitée pour l’arrosage ou l’alimentation de mares rend ce dispositif doublement utile, surtout en période de sécheresse où chaque litre d’eau compte.
Un entretien régulier mais accessible à tous
Contrairement à certaines idées reçues, le système ribo n’est pas complètement autonome. Il demande un entretien suivi pour fonctionner durablement, mais ce suivi reste accessible même aux particuliers peu expérimentés. On parle surtout de gestes simples et réguliers.
Suivi de l’écoulement et de la végétation
Il est essentiel de vérifier tous les mois que l’eau circule bien dans les différents bassins, sans stagnation excessive ni colmatage. Les plantes doivent rester en bonne santé, sans envahissement d’espèces indésirables. Tailler les roseaux une fois par an suffit généralement à conserver une bonne oxygénation du système.
Vidange des boues en entrée
Une fosse toutes eaux est souvent placée en amont du système. Celle-ci doit être vidangée environ tous les 4 à 5 ans, selon la taille du foyer et les habitudes d’utilisation. Ce point reste une contrainte identique aux systèmes traditionnels, mais elle est bien anticipable.
L’entretien courant peut être pris en charge par les usagers eux-mêmes, à condition d’être un minimum formés. C’est aussi l’occasion d’apprendre à observer la vie du sol et à comprendre les signes de bon ou mauvais fonctionnement.
Une solution bien adaptée aux zones rurales
Le système ribo trouve toute sa pertinence dans les zones rurales ou périurbaines, là où l’assainissement collectif n’existe pas ou s’avère difficile à mettre en place. Il répond aux besoins de maisons individuelles, de petits hameaux, voire de lieux collectifs comme des écovillages, des campings ou des refuges.
Sa capacité à s’intégrer discrètement dans le paysage et à valoriser un espace inutilisé (talus, zone humide, ancien fossé) en fait une solution appréciée par les architectes spécialisés en construction écologique. Un terrain d’au moins 100 à 150 m² est généralement nécessaire pour une famille de 4 à 5 personnes, ce qui est rarement un problème dans ces zones.
Dans certains cas, des systèmes collectifs de type ribo ont même été mis en œuvre pour traiter les eaux d’un petit lotissement, à moindre coût, avec des résultats de dépollution très satisfaisants : jusqu’à 95 % de réduction des DBO5 (demande biologique en oxygène).
Des contraintes réglementaires à prendre en compte
Avant de lancer un projet ribo, il faut bien comprendre le cadre réglementaire, car ce type d’assainissement non collectif est encadré par la loi et doit être validé par le SPANC (service public d’assainissement non collectif). Et c’est souvent à ce niveau que les difficultés commencent.
Acceptation locale variable
Tous les SPANC ne sont pas formés ni ouverts à ce type de système. Dans certaines communes, les projets sont refusés ou mis en attente par manque de références locales. Dans d’autres, ils sont acceptés à condition de respecter un cahier des charges strict (dimensionnement, matériaux, qualité des eaux en sortie).
Nécessité d’une étude de sol préalable
Avant tout, il faut faire réaliser une étude de sol et une évaluation de perméabilité. Cela permet de confirmer la faisabilité du projet, d’ajuster la taille des bassins et de prévoir le bon type de substrat filtrant. Ce diagnostic, obligatoire, coûte entre 300 et 800 € selon les régions.
Ces démarches sont souvent perçues comme lourdes, mais elles permettent aussi d’éviter les erreurs de conception et de sécuriser la pérennité du système.
Un investissement de départ plus élevé qu’un système classique
Le système ribo représente un coût initial plus élevé que les fosses toutes eaux classiques avec épandage. En moyenne, pour une maison de 4 personnes, il faut compter entre 7 000 et 12 000 € pour une installation complète, selon les matériaux, la complexité du terrain et le choix de l’auto-construction ou non.
Comparaison des coûts
Un épandage classique coûte entre 5 000 et 8 000 € pour une maison individuelle, tandis qu’une microstation peut grimper à 10 000 €, avec un coût d’entretien annuel compris entre 150 et 300 €. Le système ribo, lui, présente un coût d’entretien quasi nul (hors vidange), mais un investissement de départ parfois dissuasif.
Rentabilité sur le long terme
Si l’on raisonne sur 15 ou 20 ans, le système ribo devient souvent plus économique. Il ne consomme pas d’électricité, ne nécessite pas de contrat de maintenance, et permet parfois de valoriser une partie du terrain. Il est aussi plus simple à faire évoluer si les besoins changent.
Un impact environnemental positif mais pas neutre
Même si le système ribo est une alternative respectueuse, il ne faut pas en faire une solution miracle sans impact. Sa mise en œuvre implique de prélever du sable, du gravier, des géotextiles, et de creuser des tranchées ou des bassins parfois profonds.
Empreinte de la construction
La construction d’un système ribo génère une empreinte carbone initiale non négligeable, surtout si l’on fait venir les matériaux de loin ou si l’on utilise des engins lourds. Une étude réalisée en 2020 en Bretagne a montré que le bilan carbone d’une phytoépuration pouvait être compensé après 5 à 6 années d’utilisation sans énergie fossile.
Risques en cas de mauvais entretien
Un système mal entretenu peut rapidement perdre son efficacité, saturer les filtres, voire rejeter de l’eau partiellement polluée. Il ne s’agit donc pas d’un système sans entretien ni sans risque. Il faut y consacrer un peu de temps et rester attentif aux signes de dysfonctionnement.